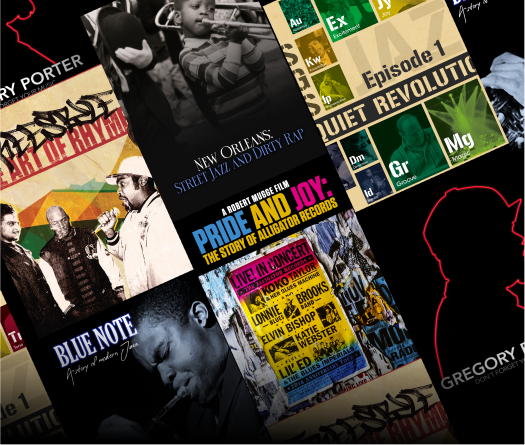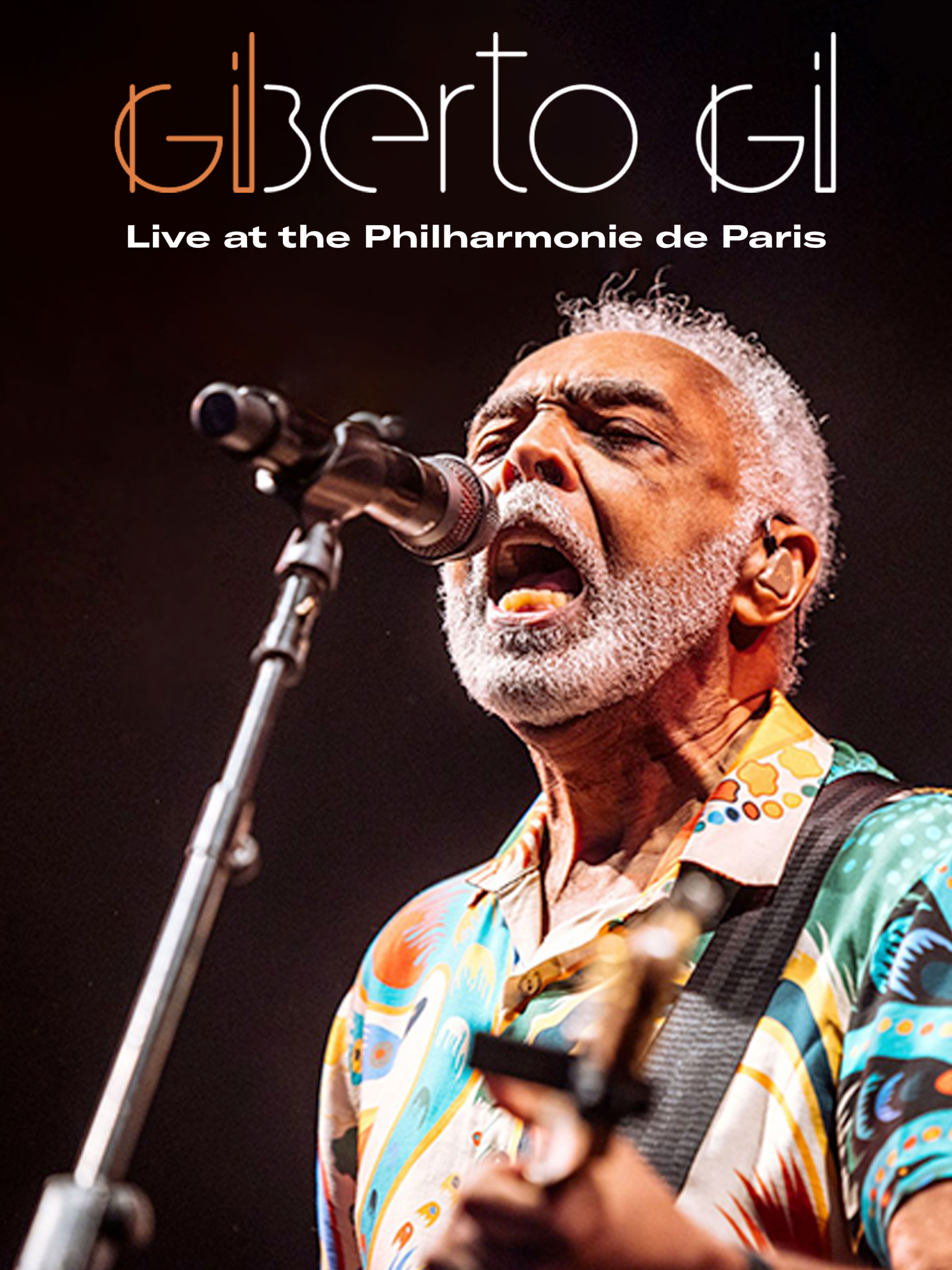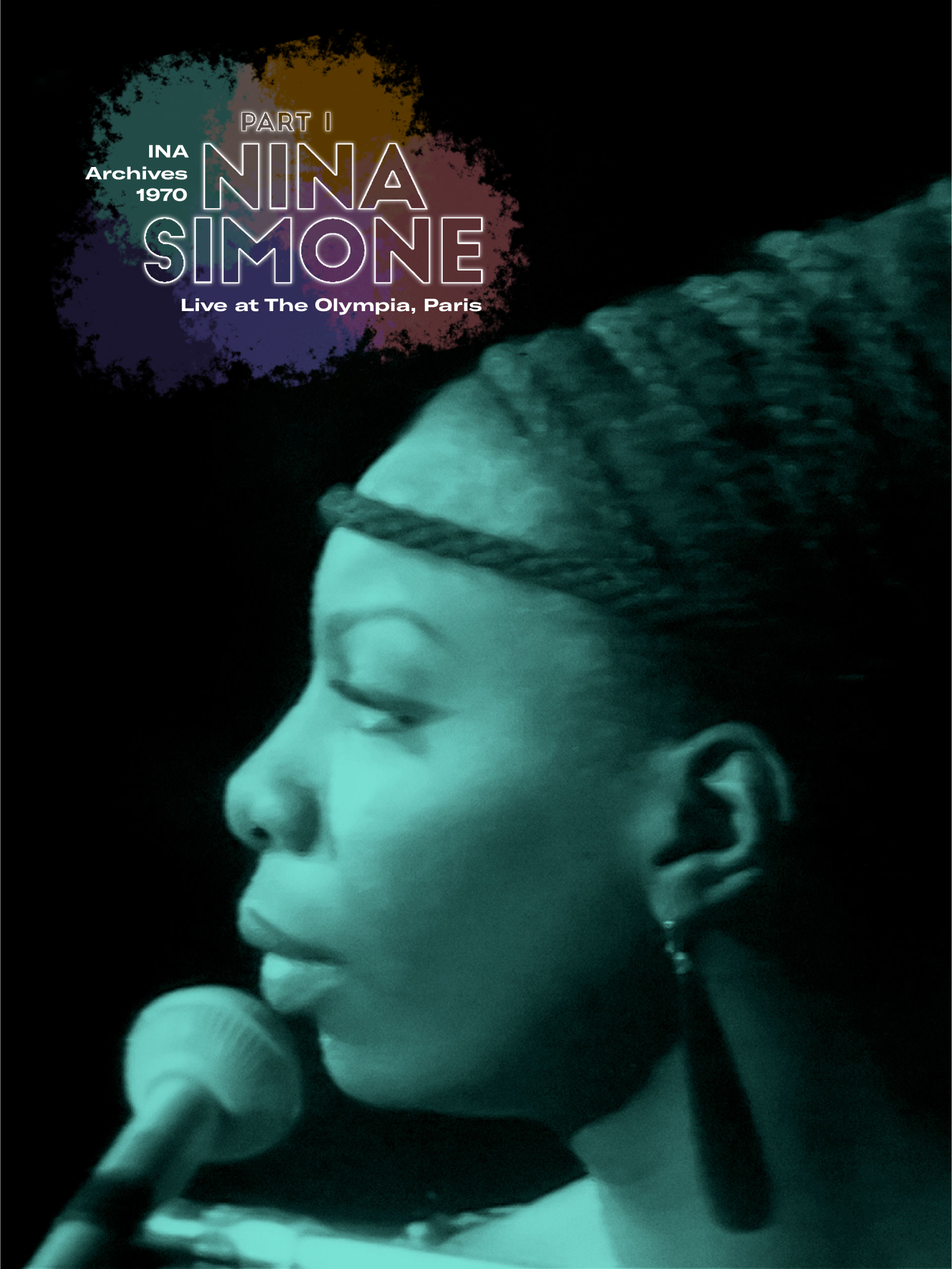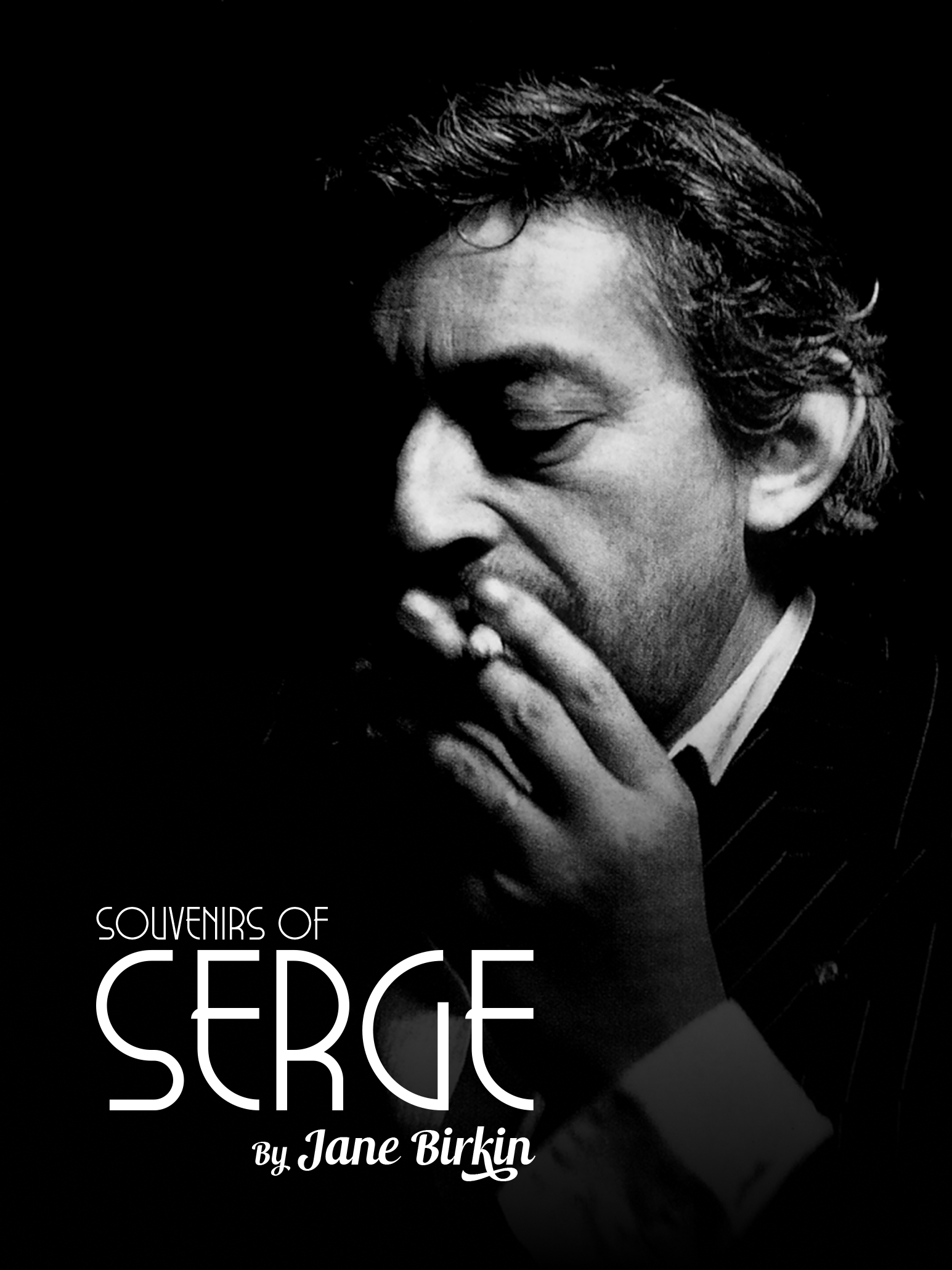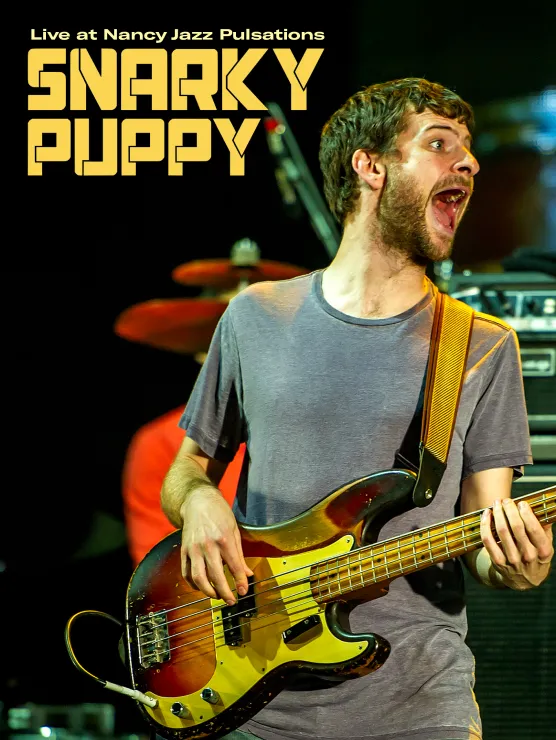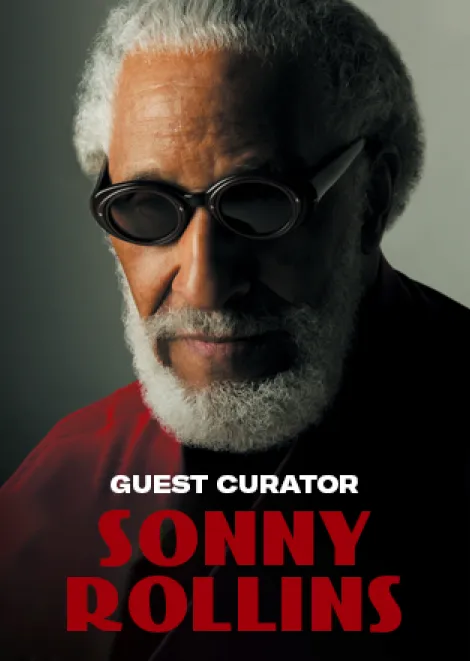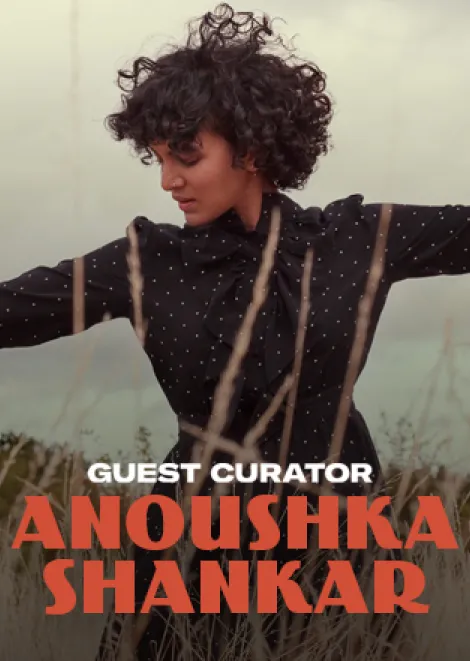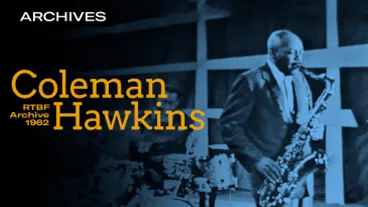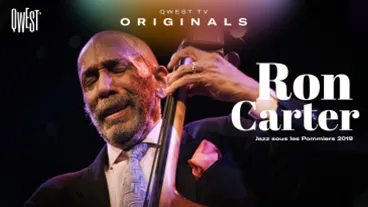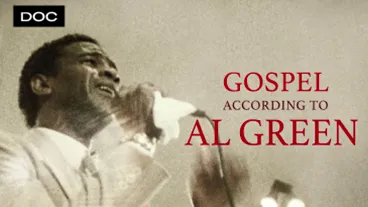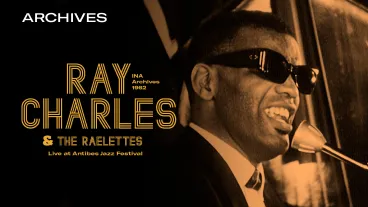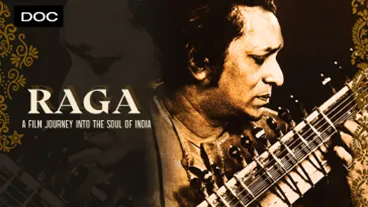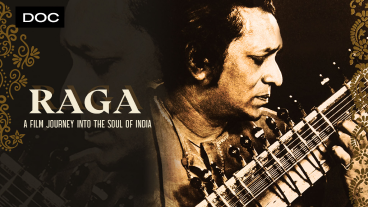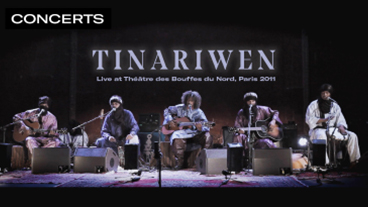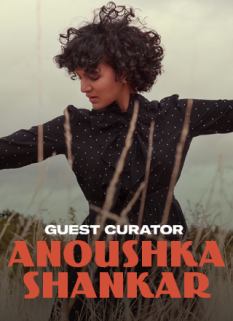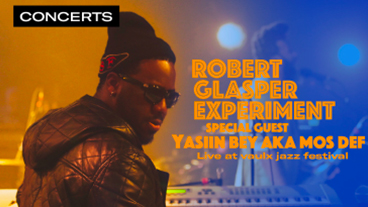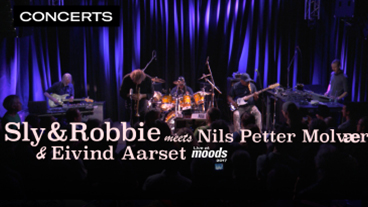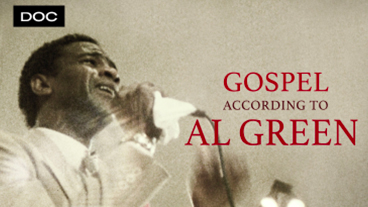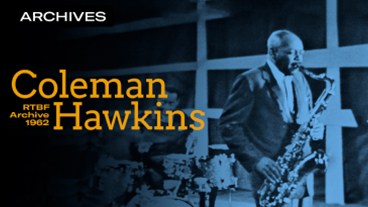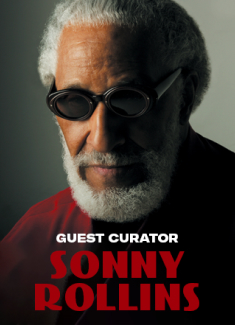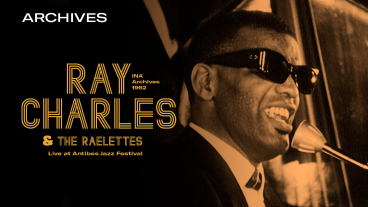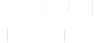QUINCY JONES' VIDEO NETWORK
FOR BLACK music & GLOBAL sounds
Try 7 days free

the best seat
in the house
Enjoy a selection of premium documentaries, concerts, archive gems and interviews. Curated by Quincy Jones, music icons and a team of experts.
the best seat
in the house
Enjoy a selection of premium documentaries, concerts, archive gems and interviews. Curated by Quincy Jones, music icons and a team of experts.
new releases
your groove
select a plan and let the music move you.
- +1300 contents
- HD or 4k
- Compatible w/ TV, computer, smartphone or tablet
- cancel anytime
where the artists
are also fans
Qwest TV is a community that hears it differently. Here’s what the legends are watching...
sonny rollins PERSONAL PLAYLIST
Daptone Recording Co. PERSONAL PLAYLIST
Gregory porter'S PERSONAL PLAYLIST
carl craig'S PERSONAL PLAYLIST
anoushka shankar'S PERSONAL PLAYLIST

“Qwest TV, a platform that provides listeners with a new and approachable way to discover the music that they were never formally introduced to. It’s time to break down the barriers for any willing ear, and Qwest TV is here to help bring you to new uncharted musical territories!”

FAQ
What is Qwest TV?
How much does Qwest TV cost?
How to watch Qwest TV?
What can I watch on Qwest TV?
Let’s groove tonight? Get your free trial.